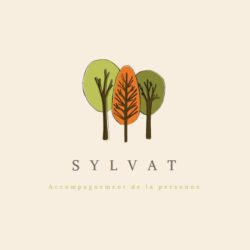Ouvrir la porte de votre thérapie est le premier pas important que vous vous apprêtez à réaliser? Je vous y accompagnerai en douceur et en sécurité.
Je vous présente sur ce site l’approche thérapeutique que je mets à votre service à Cugnaux ou à Toulouse. Vous y trouverez aussi des informations sur ma formation et les références déontologiques de ma profession.
Bonne visite!
Sylvain Richir
https://www.facebook.com/srichirpsy/
https://www.linkedin.com/in/sylvain-richir-40280826
Dépression, stress, anxiété, Angoisse, traumatisme, difficultés sociales, relationnelles, trouble réactionnel dû à un évènement de la vie (divorce, deuil, burnout…) Thérapie de Couples/Thérapie de Groupe/Analyse Transactionnelle – Psychothérapie – Aide psychologique – Psychothérapie – Anorexie – Boulimie – Addictions – Psychothérapeute -Thérapie comportementale -Thérapie couple – Dépression – Phobies Affirmation de soi – Adoption – Haute-Garonne
Thérapie de Couples/Thérapie de Groupe/Analyse Transactionnelle